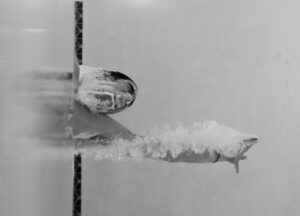Qu’est-ce qu’un juré d’assises en droit pÉnal ?
Au cœur du système judiciaire français et du droit pénal, la cour d’assises incarne l’expression la plus solennelle de la justice. Chargée de juger les crimes les plus graves – meurtres, viols, actes de torture ou barbarie – elle se distingue par l’intervention directe de citoyens ordinaires : les jurés d’assises.
Tirés au sort, ces jurés participent activement au jugement des affaires criminelles, aux côtés des magistrats professionnels. Leur présence assure une forme de représentation citoyenne au sein des procès les plus lourds de conséquences, et contribue à rapprocher la justice des valeurs de la société.
Mais qu’est-ce qu’un juré d’assises ? Quelles sont ses obligations ? Comment est-il sélectionné, convoqué et formé ? Quelle est la réalité de cette expérience, souvent intense et marquante ?
Alter Avocats, cabinet expert en droit pénal, répond à toutes vos questions sur le rôle du juré, les étapes de sélection, les responsabilités pendant le pro
Qui est le juré d'assises ?
Le saviez-vous ?
Le recours à des citoyens tirés au sort pour juger les crimes les plus graves trouve ses origines dans la Révolution française. Le jury criminel a été institué en 1791, dans un double objectif : lutter contre l’arbitraire des juges et garantir une justice rendue « au nom du peuple français ».
Inspiré des pratiques anglo-saxonnes, le jury populaire s’est imposé comme un symbole de la participation démocratique à la justice. Aujourd’hui encore, le juré d’assises incarne cette volonté d’associer des citoyens à l’exercice du pouvoir judiciaire, notamment dans les procès criminels les plus sensibles.
Ce rôle, solennel et exigeant, place chaque juré au cœur du fonctionnement de la cour d’assises, aux côtés des juges professionnels. Il rappelle que la justice n’est pas l’affaire des seuls juristes, mais aussi celle de la société tout entière.
Être juré d’assises implique des obligations civiques fortes. C’est une tâche essentielle au fonctionnement de la justice criminelle, qui s’inscrit dans une logique de représentation directe de la société au sein des tribunaux.
Le juré d’assises est un citoyen ordinaire sélectionné pour participer au jugement des affaires criminelles en cour d’assises. Contrairement aux juges professionnels, le juré n’est pas un expert du droit mais il dispose d’un pouvoir décisionnel important. En effet, son vote compte autant que celui des trois juges professionnels qui l’accompagnent.
La distinction principale entre un juré d’assises et un magistrat réside dans leur formation et leur rôle au sein du procès. Le magistrat est un juge professionnel formé pour interpréter la loi et veiller à sa juste application. Il a aussi la responsabilité de diriger les débats, de poser des questions aux témoins, aux parties civiles et à l’accusé et d’assurer un procès pénal équitable.
Le juré, quant à lui, apporte son jugement en tant que représentant de la société, sur la base du sens commun et de la notion de justice, sans qu’il soit nécessaire qu’il dispose de connaissances juridiques spécifiques.
Cette dualité entre expertise juridique et jugement citoyen enrichit le processus décisionnel.
Comment sont sélectionnés les jurés D'ASSISES ?
La procédure de sélection des jurés d’assises se veut juste et équitable et vise à constituer un jury représentatif de la société.
Les critères d’éligibilité pour être juré d’assises
Pour être éligible en tant que juré d’assises, plusieurs critères doivent être remplis. Seuls peuvent devenir jurés, les personnes :
- de nationalité française ;
- âgées d’au moins 23 ans ;
- inscrites sur les listes électorales ;
- qui jouissent de leurs droits civils, politiques et de famille ;
- qui ne se trouvent dans aucun cas d’incapacité ou d’incompatibilité prévu par la loi.
Ces critères garantissent que les personnes sélectionnées soient à même de comprendre les débats et de contribuer activement aux discussions et à la prise de décision.
Le processus de sélection des jurés
La sélection des jurés d’assises est un processus rigoureux qui commence par un tirage au sort préliminaire sur les listes électorales. Ce tirage permet d’établir une première liste de candidats, appelée la liste préparatoire.
Ensuite, une commission de sélection est chargée de dresser la liste définitive des
jurés potentiels pour l’année judiciaire. Ce comité est composé de trois magistrats du siège, d’un représentant du ministère public, du bâtonnier de l’Ordre des avocats, ainsi que de conseillers départementaux et présidé, soit par le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal judiciaire.
Les personnes sélectionnées sont ensuite convoquées par courrier à la session d’assises.
Cette technique assure que le jury soit représentatif de la société dans sa diversité, tant en termes de genre, d’âge, que de catégorie socio-professionnelle.
Les motifs d’exemption et de récusation
Bien que considérée comme un devoir civique, la fonction de juré d’assises peut être incompatible avec certaines situations personnelles ou professionnelles. Il existe en effet des motifs d’incapacité, d’incompatibilité, de dispense et d’exclusion.
L’article 256 du Code de procédure pénale détaille les incapacités à la fonction de juré :
- la mention d’une condamnation pour crime ou délit au bulletin n°1 du casier judiciaire ;
- un mandat de dépôt, un mandat d’arrêt, un état d’accusation ou de contumace ;
- une situation de faillite sans réhabilitation ;
- une sauvegarde de justice, un placement sous tutelle ou curatelle et un placement dans un établissement psychiatrique ;
- etc.
L’article 257 prévoit quant à lui les cas d’incompatibilité, parmi lesquels :
- les membres du Gouvernement, du Parlement, etc. ;
- les membres du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, les magistrats de l’ordre judiciaire, les membres des tribunaux administratifs, etc. ;
- les directeurs de ministère, les membres du corps préfectoral, etc. ;
- les fonctionnaires des services de police ou de l’administration pénitentiaire et les militaires de la gendarmerie, en activité de service.
Enfin, l’article 258 du même code dispose que les personnes âgées de plus de 70 ans, celles dont la résidence principale se trouve en dehors du département ou qui invoquent un motif grave sont dispensées des fonctions de juré.
Le saviez-vous ? – C’est la commission qui est chargée d’étudier le caractère grave du motif présenté sur la base des justificatifs fournis, afin de statuer sur sa validité. – Les personnes qui ont exercé les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans, les proches des parties (accusés, avocats, victimes, magistrats) ou les personnes ayant participé à l’enquête sont exclues d’office de la liste annuelle. |
L’indemnisation des jurés
Les jurés d’assises perçoivent une indemnisation destinée à compenser les désagréments et les frais engendrés par leur mission, tels que les pertes de revenus, les frais de transport, d’hébergement et de repas.
Le montant de cette rémunération est fixé par la loi et peut varier en fonction de plusieurs critères, liés notamment à la durée du procès et aux déplacements qu’il suppose.
Quel est le rôle du juré pendant le procès ?
La constitution du jury de jugement
Pour chaque session d’assises, 35 jurés titulaires et 10 jurés suppléants sont tirés au sort publiquement à partir de la liste annuelle et sont convoqués chaque premier jour de procès.
Chaque procès débute par la constitution de son jury de jugement.
Le(a) président(e) de la cour d’assises effectue un ultime tirage au sort pour désigner 6 jurés (9 en appel) et des jurés supplémentaires. La personne dont le nom est cité devient juré titulaire pour l’affaire en cours et doit se lever pour rejoindre la cour.
Néanmoins, l’accusé, son avocat ou l’avocat général ont la possibilité de la récuser c’est-à-dire de s’opposer à sa présence parmi les jurés.
Dans cette hypothèse, la personne doit retourner dans la salle (qu’elle peut ensuite quitter) et revenir le premier jour du procès suivant pour participer à un nouveau tirage.
Le(a) président(e) de la cour d’assises donne lecture du serment aux jurés qui, main levée, répondent « je le jure » (article 304 du Code de procédure pénale).
Les étapes clés du procès d’assises
- Lors des débats, toutes les preuves sont examinées, les parties interrogées, le réquisitoire et les plaidoiries entendues. Les jurés sont actifs, ils peuvent prendre des notes, poser des questions par le truchement du président, etc. À ce stade, ils doivent être particulièrement attentifs et veiller à rester le plus neutres et objectifs possible. Il est par ailleurs interdit aux jurés de communiquer avec d’autres personnes sur l’affaire.
- Lorsque les débats sont clos, le jury se retire pour délibérer à huis clos. Guidés par le(a) président(e) qui veille au respect de la procédure sans influencer le fond du verdict, les jurés et les juges professionnels discutent des faits et décident de la culpabilité de l’accusé selon leur intime conviction. Si celui-ci est reconnu coupable, une seconde délibération a lieu pour déterminer la peine.
- Le verdict : à l’issue du délibéré, qui peut parfois durer de longues heures, les jurés reviennent avec les magistrats dans la salle d’audience où le(a) président(e) de la cour d’assises énonce le verdict.
Être juré d’assises, c’est compliqué ?
L’impact psychologique n’est pas à négliger. Le rôle de juré d’assises plonge l’individu au cœur de récits souvent tragiques et l’expose à des détails perturbants sur des crimes. Cette proximité avec la souffrance d’autrui et la responsabilité de la tâche – décider du sort d’une personne – peuvent s’avérer éprouvantes.
De plus, les jurés doivent faire preuve d’une grande intégrité éthique en jugeant de manière équitable, neutre et impartiale, en se basant sur les faits et les preuves et non sur leurs émotions.
Par ailleurs, la durée d’une session d’assises est généralement de 15 jours à 3 semaines. Dans la mesure où il est possible d’être tiré au sort à plusieurs reprises, certaines personnes sont amenées à juger plusieurs affaires successives.
L’implication directe du peuple dans la justice pénale est un pilier du système judiciaire français et de la démocratie. La fonction de juré d’assises incarne en effet un engagement civique complexe et humainement coûteux. Pour autant, la compétence des cours d’assises est peu à peu vidée de sa substance.
La loi de programmation pour la justice du 23 mars 2019 puis la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire du 22 décembre 2021 ont mis en place, depuis le 1er janvier 2023, les cours criminelles départementales (CCD), exclusivement composées de magistrats professionnels et chargées de juger les crimes passibles de 15 à 20 ans de réclusion criminelle.
Est-ce à dire que les jurys populaires vont disparaître ? L’avenir le dira. Si vous avez des questions complémentaires relatives au juré d’assises, à la cour d’assises ou plus généralement à la procédure pénale, les experts Alter Avocats se feront un plaisir de vous répondre. Contactez-les !