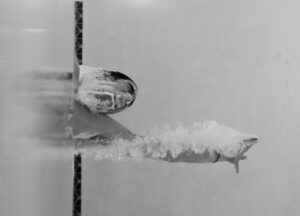Les droits financiers lors du divorce
La prestation compensatoire : modalités et calcul
Le divorce peut créer un déséquilibre dans les conditions de vie respectives des époux. Pour compenser cette situation, l’un des conjoints peut demander une prestation compensatoire. Cette somme vise à rétablir l’équilibre financier entre les parties après la séparation et constitue un élément central du règlement des intérêts financiers.
À retenir : Le juge aux affaires familiales examine plusieurs critères pour déterminer le montant et les modalités de versement de la prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales examine plusieurs critères pour déterminer le montant et les modalités de versement :
- La durée du mariage
- L’âge et l’état de santé des époux
- Leur qualification professionnelle et leur situation professionnelle
- Les conséquences des choix professionnels faits pendant le mariage
- Le patrimoine estimé ou prévisible des époux
- Leurs droits existants et prévisibles
- Leur situation respective en matière de pensions de retraite
La prestation compensatoire en capital prend généralement la forme d’un versement en une fois ou de manière échelonnée sur une période maximale de huit ans. Dans certains cas exceptionnels, elle peut être versée sous forme de rente viagère. Le calcul de la soulte matrimoniale intervient lorsque l’un des époux conserve un bien commun et doit compenser l’autre.
La pension alimentaire pour les enfants
Après le divorce, les deux parents conservent l’autorité parentale et doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. Le parent chez qui les enfants ne résident pas habituellement verse une pension alimentaire à l’autre parent.
Le montant de la pension alimentaire dépend des besoins de l’enfant, des ressources du parent débiteur et des ressources du parent créancier.
Le montant de cette pension dépend de trois éléments :
- Les besoins de l’enfant (scolarité, santé, loisirs, logement)
- Les ressources du parent débiteur
- Les ressources du parent créancier
Cette pension est révisable à tout moment en cas de changement dans la situation de l’un des parents ou dans les besoins de l’enfant. Elle est indexée annuellement selon l’indice des prix à la consonsommation.
Le partage des biens et la liquidation du régime matrimonial
Les règles selon le régime matrimonial
Le partage des biens dépend du régime matrimonial choisi lors du mariage. En France, le régime légal est celui de la communauté réduite aux acquêts. La liquidation du régime matrimonial intervient après le prononcé du divorce et organise la répartition du patrimoine commun.
Les trois masses de biens dans le régime de communauté réduite aux acquêts :
- Les biens propres de chaque époux (biens possédés avant le mariage, héritages, donations)
- Les biens communs (acquisitions réalisées pendant le mariage avec les revenus du couple)
Dans ce régime, trois masses de biens coexistent :
- Les biens propres de chaque époux (biens possédés avant le mariage, héritages, donations)
- Les biens communs (acquisitions réalisées pendant le mariage avec les revenus du couple)
Seuls les biens communs font l’objet d’un partage lors du divorce. Chaque époux récupère ses biens propres et reçoit la moitié de la valeur des biens communs. La liquidation du patrimoine commun nécessite souvent l’intervention d’un notaire pour établir un acte de partage.
Pour les couples mariés sous le régime de la séparation des biens, chacun conserve les biens acquis en son nom propre. Pour ceux mariés sous le régime de la communauté universelle, tous les biens sont communs et partagés par moitié. Le droit de partage à payer correspond à une taxe fiscale de 2,5% sur la valeur des biens partagés.
Le logement familial et les mesures provisoires
Le sort du logement familial constitue souvent un point de négociation important. Plusieurs solutions existent :
- L’attribution du logement à l’un des époux, avec compensation financière pour l’autre
- La vente du bien et le partage du produit de la vente
- L’indivision temporaire, notamment lorsque des enfants mineurs résident dans le logement
Le juge peut prononcer une ordonnance de sauvegarde pour l’usage exclusif du logement au profit de l’un des époux pendant la procédure. Ces mesures provisoires en instance de divorce permettent d’organiser la vie quotidienne avant le jugement définitif. Une convention d’indivision pour le logement peut également être mise en place pour gérer temporairement le bien immobilier.
Les droits relatifs aux enfants et le droit de garde
L’autorité parentale
Le divorce ne modifie pas l’autorité parentale. Les deux parents conservent les mêmes droits et devoirs envers leurs enfants.
Le divorce ne modifie pas l’autorité parentale. Les deux parents conservent les mêmes droits et devoirs envers leurs enfants. Ils doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’éducation et l’orientation scolaire des enfants.
Cette règle s’applique sauf circonstances exceptionnelles où l’intérêt de l’enfant justifie que l’autorité parentale soit exercée par un seul parent.
La résidence des enfants et le droit de garde
Plusieurs modalités de résidence peuvent être fixées dans le cadre du droit de garde :
- La résidence alternée, où l’enfant vit en alternance chez chaque parent selon un rythme défini
- La résidence habituelle chez l’un des parents, avec un droit de visite et d’hébergement pour l’autre
Critères de décision du juge : Le juge décide en fonction de l’intérêt de l’enfant, en tenant compte de ses souhaits s’il est capable de discernement, de l’âge de l’enfant, de la proximité géographique des domiciles parentaux et de la disponibilité de chaque parent.
Le juge décide en fonction de l’intérêt de l’enfant, en tenant compte de ses souhaits s’il est capable de discernement, de l’âge de l’enfant, de la proximité géographique des domiciles parentaux et de la disponibilité de chaque parent. Le droit de l’épouse en cas de divorce est identique à celui de l’époux concernant la garde des enfants.
Le droit de visite et d’hébergement
Le parent chez qui l’enfant ne réside pas habituellement bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement. Ce droit s’exerce généralement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, mais d’autres modalités peuvent être définies.
Ce droit peut être restreint ou exercé dans un lieu médiatisé en cas de danger pour l’enfant ou de circonstances particulières.
Les obligations qui cessent après le divorce
Le devoir de fidélité et de cohabitation
Dès le prononcé du divorce, les obligations matrimoniales prennent fin. Les ex-époux ne sont plus tenus au devoir de fidélité, de cohabitation, d’assistance et de respect mutuel qui caractérisent le mariage.
Chacun retrouve sa liberté personnelle et peut refaire sa vie sans contrainte juridique liée au mariage précédent.
Le nom d’usage
Après le divorce, chaque époux perd en principe l’usage du nom de famille de l’autre. Toutefois, il est possible de conserver ce nom dans deux situations :
- Avec l’accord écrit de l’ex-conjoint
- Avec l’autorisation du juge si l’intérêt personnel ou celui des enfants le justifie (notoriété professionnelle par exemple)
Les différentes procédures de divorce
Le divorce par consentement mutuel
Depuis 2017, le divorce par consentement mutuel ne nécessite plus l’intervention d’un juge. Les époux d’accord sur le principe du divorce et ses conséquences rédigent une convention avec leurs avocats respectifs.
Avantages du divorce par consentement mutuel : Procédure rapide (environ trois mois) et moins coûteuse que les autres formes de divorce.
Cette convention règle l’ensemble des effets du divorce : partage des biens, prestation compensatoire, résidence des enfants, pension alimentaire. Elle est ensuite déposée chez un notaire qui lui confère sa force exécutoire.
Cette procédure présente l’avantage d’être rapide (environ trois mois) et moins coûteuse que les autres formes de divorce. Le divorce par consentement mutuel simplifie également la liquidation des régimes matrimoniaux lorsque les époux s’accordent sur la répartition.
Les divorces contentieux et les mesures provisoires
Lorsque les époux ne parviennent pas à s’entendre, trois types de divorce contentieux existent :
- Le divorce accepté : les époux sont d’accord sur le principe du divorce mais pas sur ses conséquences
- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal : les époux sont séparés depuis au moins deux ans
- Le divorce pour faute : l’un des époux a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage
Les procédures contentieuses nécessitent l’intervention du juge aux affaires familiales et prennent généralement entre un et trois ans selon la complexité du dossier.
Ces procédures nécessitent l’intervention du juge aux affaires familiales et prennent généralement entre un et trois ans selon la complexité du dossier et l’encombrement du tribunal. Pendant cette période, des mesures provisoires peuvent être ordonnées pour organiser la séparation : attribution du logement, fixation d’une pension alimentaire provisoire, organisation du droit de garde temporaire.
Les démarches administratives après le divorce
La modification de l’état civil
Après le prononcé du divorce, le jugement doit être transcrit sur les actes d’état civil. Cette formalité est accomplie par le greffe du tribunal qui transmet le jugement à la mairie du lieu de mariage.
Il convient ensuite de faire modifier de nombreux documents : carte d’identité, passeport, carte grise, contrats d’assurance, comptes bancaires, déclarations fiscales.
Les conséquences fiscales
L’année du divorce, les ex-époux doivent déposer deux déclarations de revenus distinctes. Chacun déclare les revenus perçus pendant la période où il était imposable séparément.
Fiscalité de la prestation compensatoire : La prestation compensatoire versée sous forme de capital est déductible du revenu imposable du débiteur (dans certaines limites) et imposable pour le créancier.
La prestation compensatoire versée sous forme de capital est déductible du revenu imposable du débiteur (dans certaines limites) et imposable pour le créancier. Les pensions alimentaires pour enfants sont déductibles et imposables selon des règles spécifiques.
Le parent qui assume la charge principale des enfants peut bénéficier d’une majoration du quotient familial.
L’accompagnement juridique et l’aide juridictionnelle
Le recours à un avocat est obligatoire pour toutes les procédures de divorce, y compris le divorce par consentement mutuel. Chaque époux doit avoir son propre avocat pour garantir la défense de ses intérêts.
L’avocat conseille son client sur ses droits, négocie les conditions du divorce, rédige les actes nécessaires et représente son client devant le juge le cas échéant.
L’avocat conseille son client sur ses droits, négocie les conditions du divorce, rédige les actes nécessaires et représente son client devant le juge le cas échéant. Il accompagne également son client dans la liquidation du régime matrimonial et le partage des biens.
L’aide juridictionnelle : Pour les personnes disposant de ressources limitées, l’aide juridictionnelle permet de bénéficier d’une prise en charge totale ou partielle des honoraires d’avocat. Elle est accordée sous conditions de ressources et couvre également les frais de procédure.
Pour les personnes disposant de ressources limitées, l’aide juridictionnelle permet de bénéficier d’une prise en charge totale ou partielle des honoraires d’avocat. L’aide juridictionnelle pour divorce est accordée sous conditions de ressources et couvre également les frais de procédure. Cette aide facilite l’accès au droit et permet à chacun de faire valoir ses droits, quel que soit son niveau de revenus.